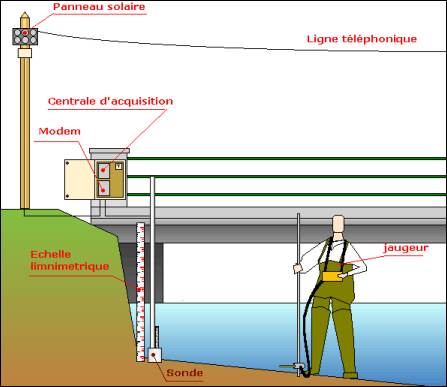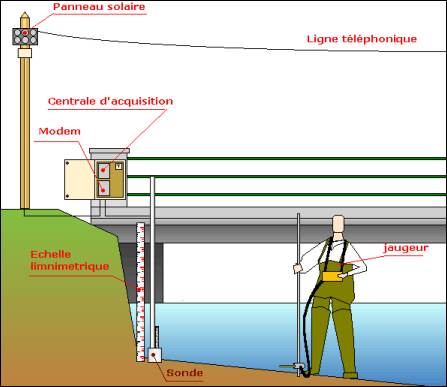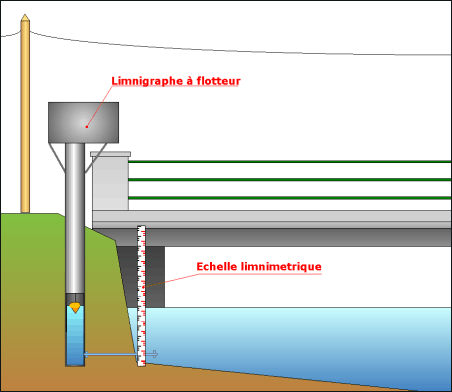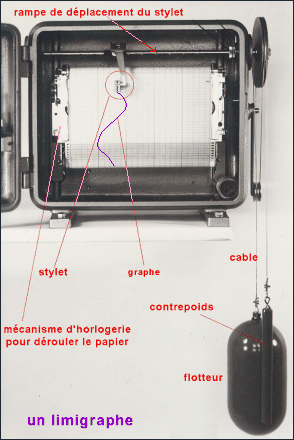Descriptif
• Généralités
Le débit
d'une rivière représente le volume d'eau s'écoulant en un temps donné
(en une seconde en général) à un moment précis et à un endroit précis
de cette rivière.
Cette notion de débit (que l'on
exprime le plus souvent en m3/s) ne doit pas être confondue avec celle
de la vitesse du courant ou de la section mouillée (profondeur d'eau x
largeur de la rivière).
La connaissance des débits des rivières et de leurs variations (régime hydrologique) est nécessaire pour divers objectifs :
- connaissance générale des ressources en eau de surface.
- dimensionnement des ouvrages de franchissement (ponts).
- protection (avec ses limites) des lieux habités.
- réponses à des demandes de prélèvement ou de rejet.
- Suivi et gestion des prélèvements (irrigation, par exemple).
Il n’y a
pratiquement pas, pour des raisons de coût et de complexité des
installations, d'enregistrement direct des débits de rivières.
Le suivi du débit des rivières se fait au moyen d'un réseau hydrométrique composé d'un ensemble de stations hydrométriques comprenant principalement des stations de jaugeage et quelques stations limnimétriques ou limnigraphiques
(les stations limnimétriques sont dédiées à l'enregistrement des hauteurs d'eau uniquement)
Les principes de base des stations de jaugeage existantes sont les suivants :
- enregistrements en continu
(par enregistreur électronique) des hauteurs d ‘eau mesurées par un
capteur et contrôlées avec une échelle graduée de référence,
- réalisation de mesures de débit (appelées : jaugeages), qui consistent à mesurer en même temps la section mouillée de la rivière et les vitesses de l ‘eau en de nombreux points de cette section (près de 10 jaugeages par an et par station)
- établissement d’une relation entre hauteurs et débits (appelée : courbe de tarage ).
- conversion, par calculs, de la chronique des
hauteurs enregistrées en chronique des débits en utilisant la courbe de
tarage.
Pour qu‘ un site
permette d’établir une chronique de débits, il faut que la relation
hauteur-débit (courbe de tarage) soit stable pendant des périodes d’une
durée suffisante (plusieurs années, plusieurs mois dans certains cas).
D’autres contraintes (absence
de bras multiples, accès du site en tous temps…) font que le nombre de
sites susceptibles de convenir sont en nombre limité et qu’ils
nécessitent parfois des aménagements pour fournir des données fiables,
particulièrement en basses eaux.
Le choix de l'emplacement d'une
station de jaugeage est d'autant plus important qu'elle est destinée à
rester longtemps en place. En effet la fiabilité et la représentativité
de ses données ne présenteront vraiment d'intérêt qu'après au moins 10
ans de fonctionnement et plus les chroniques de hauteurs et de
débits seront longues, plus intéressantes seront les valeurs
statistiques calculées.
Chaque rivière ne peut évidemment pas être suivie par une station de jaugeage, les choix qui ont été faits à travers le réseau existant
privilégient la Loire et ses principaux affluents (avec éventuellement
plusieurs stations d'amont en aval) mais également des rivières
représentatives d'un point de vue géographique, taille et typologie du
bassin versant, type d'écoulement, réactivité etc. de manière à pouvoir
utiliser la connaissance acquise à partir de ces stations pour répondre
à des demandes portant sur des rivières similaires ne bénéficiant pas
d'un suivi par une station.
En ce qui concerne
les rivières dont l'alimentation de base provient de l'aquifère des
calcaires de Beauce (on parle dans ce cas de rivières exutoires de la nappe de Beauce),
en complément des données fournies par les stations de jaugeage en
place dans ce secteur, un suivi régulier d'autres rivières est effectué
depuis 1997 à une fréquence de 4 à 5 semaines.
Ces mesures ponctuelles de débits tout au long de l'année permettent
d'établir des corrélations entre le niveau de remplissage de la nappe de Beauce et les écoulements des rivières concernées par cet aquifère.
Des jaugeages ponctuels
sont également réalisés hors des stations de jaugeage, soit pour
répondre à des demandes particulières (qualité des eaux en
particulier), soit pour contribuer à la connaissance générale des
régimes hydrologiques des cours d'eau de la région. Toutes les mesures
effectuées (plus de 15 000 mesures sur 1600 points de mesures !) ont
été entrées dans une base de données
• Le réseau hydrométrique
Afin de connaître
les hauteurs et les débits des principaux cours d'eau de la région, la
DREAL Centre Val de Loire gère un réseau de 54 stations
hydrométriques dans la Région Centre Val de Loire
(48 stations de jaugeage et 6 stations limnimétriques ou limnigraphiques ).
Ce réseau a bénéficié, pour sa modernisation, d'une participation financière de la Région Centre Val de Loire (Contrat de Plan Etat-Région) et des deux Agences de l'Eau (Loire-Bretagne et Seine-Normandie).
Les deux Agences de l'Eau apportent leur contribution financière à la DREAL pour l'exploitation du réseau
Chaque station
mesure en continu la hauteur d'eau en un point donné d’une rivière. Le
suivi des débits est obtenu par la conversion des hauteurs à l’aide des
courbes de tarage, élaborées à partir des jaugeages.
Un important
travail de terrain (maintenance des stations hydrométriques et
réalisation des mesures par les jaugeurs) permet de garantir la
fiabilité des données.
Au bureau, après
le dépouillement des mesures et l'établissement des courbes de tarage,
les fichiers des hauteurs enregistrées et les courbes de tarage sont
validés puis envoyés dans la banque nationale HYDRO du MEEDDM
(Ministère de l’Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de
la Mer), qui effectue le calcul et le stockage des débits journaliers
ainsi que de nombreux calculs d'hydrologie.
Parmi ces
stations, auxquelles s’ajoutent 27 stations gérées par des DREAL
voisines et 1 gérées par E.D.F. , une bonne partie est également
utilisée à des fins de police de l’eau, dans le cadre des situations de
crise (étiages sévères, crues exceptionnelles…).
• Station de jaugeage
C’est une station hydrométrique sur laquelle, régulièrement, des mesures de débit instantané ou jaugeages sont effectués. Elle se compose des éléments suivants :
une échelle limnimétrique pour la lecture de la hauteur et le contrôle de l'appareillage.
un limnigraphe à flotteur ou une centrale à capteur pour l’enregistrement en continu des hauteurs
éventuellement un modem pour la télétransmission des données
station de jaugeage actuelle
• Qu'est ce qu' un jaugeage ?
Un jaugeage
consiste à mesurer le débit instantané d’un cours d’eau en un point
donné. Pour ce faire il existe plusieurs méthodes, dont :
la dilution (méthode chimique par injection d’un traceur puis brassage et prélèvement aval)
le flotteur (exploration des vitesses de surfaces)
le moulinet à
hélice ou le courantométre (exploration complète du champ des vitesses
dans la section considérée)
Cette dernière méthode est la plus utilisée par les jaugeurs
sur la région Centre Val de Loire. Le soin apporté à ces mesures est
une très bonne base pour l'établissement de la courbe de tarage.
• Les jaugeurs ou techniciens d'hydrométrie
Ce sont les
acteurs principaux de l’hydrométrie. Spécialistes de la mesure en
rivière dont l’activité s’est étoffée au fil des années avec l’arrivée
de nouvelles technologies comme l’informatique, la télétransmission…
Leur activité
consiste non seulement à la gestion du parc de stations et la mesure
des débits mais aussi au dépouillement des données , à
l'alimentation de la banque nationale HYDRO
, à la critique , la validation et la diffusion des données. Le
technicien en hydrométrie partage donc son activité entre terrain et
bureau.
L'hydrologue est
l'utilisateur principal des mesures effectuées par les techniciens, son
rôle consiste à effectuer la synthèse des données hydrologiques
produites par les stations de jaugeage, à les comparer entre elles, à
les croiser avec d'autres paramètres (pluviométrie, état et réactivité
des nappes souterraines, influence des activités humaines etc.), à
essayer de comprendre les phénomènes en jeu et leur évolution afin de
pouvoir répondre aux nombreuses demandes.
• Les évolutions
station de jaugeage ancienne
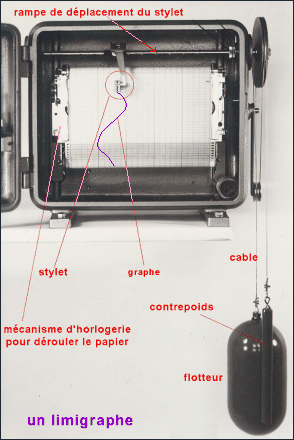
Le dispositif d'enregistrement des hauteurs,
jusqu'à il y a une dizaine d'année, comportait un limnigraphe
dont le mécanisme
d'horlogerie entraînait le déroulement d'un rouleau de papier gradué
derrière un stylet à encre
lequel se déplaçait
sur une rampe horizontale en suivant le mouvement d'un flotteur
transmis par un câble d'acier.
Le flotteur reposant
à la surface d'un puits vertical en communication avec la
rivière, montait ou descendait en mème temps.
Le graphe enregistré sur le papier
était prélevé toutes les 4 semaines au maximum (autonomie de l'horloge)
puis une opération
assez longue de digitalisation de l'enregistrement était nécessaire
avant de pouvoir injecter dans la banque nationale hydro
les données numériques des hauteurs
Enfin une vérification minutieuse des
listings issus de la banque hydro était un préalable à la validation
des données de hauteurs.
Il faut noter que certains de ces limnigraphes sont encore en service
(depuis plus de 30 ans !) et que la précision obtenue était presque
comparable à celle des capteurs actuels. Les données anciennes stockées
dans la banque ne sont donc pas imprécises. Le bénéfice principal de la
modernisation réside essentiellement dans la plus grande
rapidité du traitement et la possibilité de télétransmission.